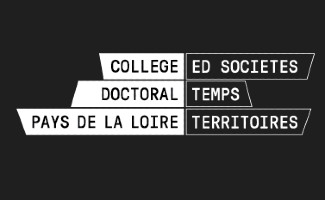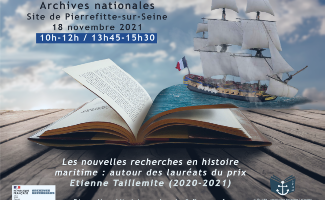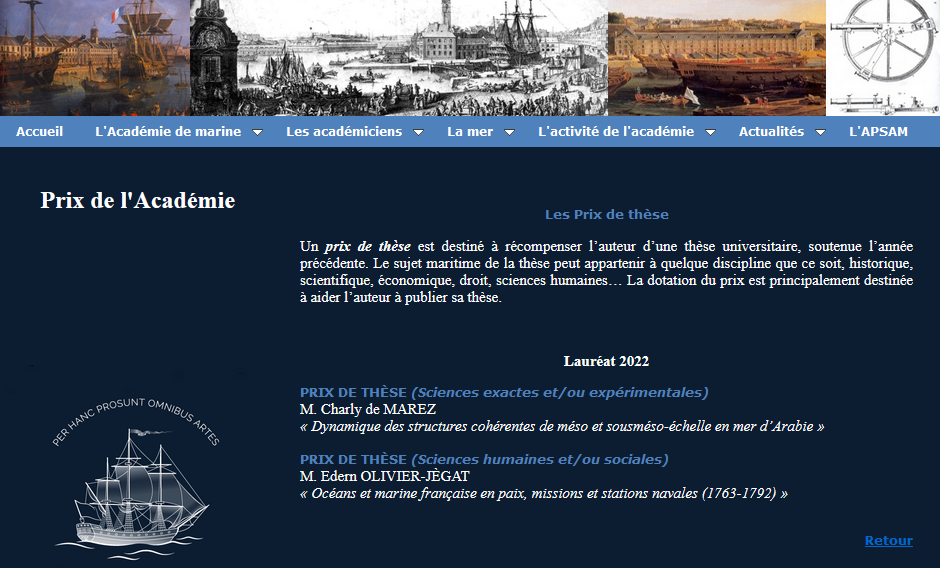Soutenu par la Commission européenne, le projet de recherche Breath (BRinging hEAlTH and social sciences to a new level through an interdisciplinary doctoral programme) cofinance un programme doctoral à l’interface des sciences humaines et sociales (SHS) et des disciplines de santé pour vingt jeunes chercheur∙es des Universités d’Angers, de Nantes, et du Mans. Le projet débutera en septembre 2025.
Soutenu par la Commission européenne, le projet de recherche Breath (BRinging hEAlTH and social sciences to a new level through an interdisciplinary doctoral programme) cofinance un programme doctoral à l’interface des sciences humaines et sociales (SHS) et des disciplines de santé pour vingt jeunes chercheur∙es des Universités d’Angers, de Nantes, et du Mans. Le projet débutera en septembre 2025.
Porté par l’Université d’Angers, son objectif est de renforcer l’attractivité du doctorat sur le territoire régional. Le projet Breath s’étale sur cinq années, avec un coût de 5 millions d’euros dont la moitié est financé par la Commission européenne.
« C’est un projet ambitieux qui regroupe six écoles doctorales et 54 laboratoires des trois universités ligériennes, avec le soutien de 28 partenaires, détaille Sébastien Fleuret, directeur de recherche du laboratoire ESO et coordinateur scientifique du projet. La formation inclura un accompagnement au projet professionnel afin d’ouvrir des portes aux futurs docteurs dans et hors du champ académique, vers le monde économique et la société civile. »
Les différents laboratoires SHS et santé des universités ont été sollicités pour proposer des sujets de thèses dans les domaines suivants : technologie en santé et prévention des maladies, sociétés plus inclusives et démocratiques, qualité de vie et écosystèmes vertueux, systèmes de santé et de soins… Ces sujets ont été évalués par un comité d’experts et vingt projets seront financés en deux cohortes (dix en septembre 2025 et dix l’année suivante). Ce programme est destiné aux doctorant∙es venant de l’étranger, ou ayant étudié au moins un an hors de France pendant les trois dernières années.
La liste des sujets ouverts aux candidatures est disponible ici:
https://breath.univ-angers.fr/en/apply/phd-opportunities.html
Trois sujets sont encadrés ou co-encadrés par des membres de TEMOS:
– Histoire comparée des dispositifs de prévention en psychiatrie (France, Canada 1930-1980) (Dir. Hervé Guillemain)
– Le patient et son dossier médical partagé informatisé. Étude d’une forme d’ego-archives en Belgique francophone, en France et au Luxembourg (Dir. Patrice Marcilloux)
– Children’s Healthcare Involvement and Leadership in Decision-making (Dir. Mickaël Dinomais, co-dir. Yves Denéchère)
La date limite pour candidater est fixée au 13/03/2025.

Depuis plusieurs années, les doctorant·es de TEMOS, soutenu·es par le laboratoire, ont pris l’initiative d’organiser une journée d’étude à destination de leurs pairs. Cette journée, pensée comme un moment convivial, de rencontre et d’échanges, est le moyen de créer du lien entre les doctorant·es des trois sites de TEMOS et d’offrir un espace où chacun·e peut venir communiquer sur ses objets de recherche en toute bienveillance.
Après l’édition de 2022, au Mans, sur la manière de faire parler les sources et celle de 2023, à Angers, sur l’imprévu dans la recherche, l’édition 2024 aura lieu le 13 juin, à l’Université Bretagne Sud à Lorient, et sera intitulée «Individus et sociabilités».
Consulter l’argumentaire complet (pdf)
Le programme de la journée sera disponible courant mai.
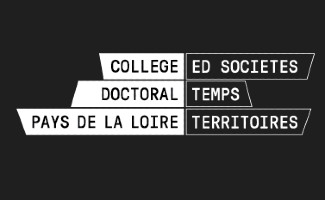
L’UMR TEMOS propose deux sujets au concours organisé par l’école doctorale Sociétés, Temps, Territoires:
- Déviances juvéniles : trajectoires institutionnelles & construction des savoirs, entre sphère pénale et psychiatrie ; France, 1870-1940
Direction Yves Denéchère, co-direction David Niget
Ce projet se donne pour objectif de comprendre comment les sociétés occidentales, et notamment la France, façonnent, de la fin du 19e siècle au milieu du 20e siècle, un nouveau système normatif autour du concept de déviance, désignant ainsi une population d’individus jugés à la fois vulnérables et dangereux, lesquels doivent être conjointement pris en charge par deux grands types d’institution : l’asile et la prison. Il s’agira de comprendre comment se construisent les savoirs sur la déviance à travers l’analyse des pratiques des institutions psychiatriques et pénales, mais aussi d’appréhender les trajectoires institutionnelles des populations ainsi étiquetées comme déviantes, mettant ainsi au jour les circulations des idées comme des populations entre ces deux instances disciplinaires. À travers le concept de déviance, il s’agira de travailler sur la frontière mouvante entre le pathologique et le délictueux, en prêtant attention aux modes de régulations ordinaires de comportements jugés irréguliers. Un regard sera porté sur la prise en charge de la jeunesse – un âge social incarnant cette double emprise de la vulnérabilité et du risque social – au sein de ces institutions, qu’il s’agisse d’institutions de correction pour mineures et mineurs, des jeunes majeurs dans les institutions pénales, ou de leur place dans les institutions psychiatriques.
- Renaître de la division : les stratégies de la noblesse d’Auvergne, XIIIe-XVe siècle
Direction Laurent Vissière
Au cours de son règne, Philippe Auguste étend son influence sur le riche et puissant comté d’Auvergne, dont il arrache la suzeraineté aux Plantagenêt (1189) et qu’il finit par occuper militairement (1213-1215). Pour mieux soumettre ce très vaste territoire, il le subdivise en plusieurs ensembles inégaux. Il confisque une grande partie des territoires, qu’il rattache au domaine royal sous le nom de Terre d’Auvergne (transformée plus tard en duché) ; mais il laisse subsister un comté, extrêmement réduit, autour de Vic-le-Comte, ainsi qu’une multitude de petites et moyennes seigneuries. Toute la question est de comprendre comment les lignages locaux réagissent à cette situation inédite, et comment ils se repositionnent dans cette Auvergne entièrement recomposée. Quelles sont les logiques de résistance et d’intégration au pouvoir capétien entre ce qu’il est convenu d’appeler la « conquête » et l’intégration définitive de toute la province au XVIe s. ? C’est en effet en privilégiant une étude sur le temps long (environ trois siècles) que l’on pourra arriver à mieux comprendre les stratégies développées par la noblesse auvergnate, et notamment par quelques grands lignages, comme, par exemple, les La Tour d’Auvergne et les La Fayette. Ces stratégies politiques se développent à plusieurs niveaux. Au plus haut niveau, ces familles envoient certains de leurs membres à la cour, briguer des honneurs et des charges : au début du XVe siècle, le maréchal Gilbert III du Motier de La Fayette joue ainsi un rôle militaire de premier plan auprès du dauphin Charles. Au niveau régional, ils affichent le plus souvent leur loyauté en traitant avec les agents du roi, mais ce loyalisme leur permet aussi de sauvegarder une autorité féodale menacée. Leur objectif est clairement de renforcer leur légitimité, en l’appuyant à la fois sur un ancrage local et ancien, fortement mis en valeur, et sur le service du roi. En l’absence de toute figure princière en Auvergne méridionale, certaines familles arrivent à se hisser très haut, notamment celle de La Tour d’Auvergne qui finit par récupérer le prestigieux titre comtal, mais qui ne parvient pas pour autant à reconstituer l’ancien comté d’Auvergne.
Consulter la description complète des deux sujets et la procédure de candidature

Ce sujet de thèse est proposé par Philippe Blaudeau, qui sera le directeur de la/du futur‧e doctorant‧e.
La Collectio Avellana offre une richesse documentaire inouïe concernant la fin de l’Antiquité, la fin de l’Empire romain et l’affirmation de la papauté comme son héritière. Ce recueil est daté du deuxième tiers du VIe siècle mais l’identité de son compilateur et ses intentions restent une énigme. C’est à un extraordinaire jeu de piste que répond donc le projet en mobilisant un concept original susceptible de faire apparaître un étonnant dessein d’ensemble.
Telle qu’elle se présente à nous en effet , la Collectio Avellana est constituée de 244 pièces, en majorité pontificales et impériales, qui s’échelonnent du pontificat de Damase (366), jusqu’au constitutum de Vigile (553), document qui constitue son terminus post quem. L’un des deux manuscrit conservant cet ensemble est le Vaticanus Latinus 4961 autrefois possédé par le monasterium Sanctae Crucis in Fonte Avellana, d’où vient le nom attribué à la collection. Or, celle-ci nous apporte 200 textes inconnus par ailleurs qui informent considérablement notre connaissance factuelle de l’histoire de la papauté. Si ce recueil a été édité scientifiquement par O. Günther à la fin du XIXe s, il n’a jamais été traduit dans une langue moderne ni commenté dans son ensemble. Bien plus, malgré plusieurs réunions scientifiques et même un ouvrage collectif réunis récemment sur ce sujet, un consensus scientifique tarde à se dégager sur l’identité et les intentions du compilateur. Ainsi le sujet est-il d’une actualité scientifique brûlante. Mais son importance ne se limite pas à ce seul enjeu car il se situe aux origines de l’histoire européenne. En effet, il interroge fortement notre compréhension de la fin de l’Empire romain d’Occident, de l’affirmation du siège de Rome et de ses rapports avec l’Empire romain d’Orient mais aussi avec le royaume ostrogothique d’Italie. Surtout, il affronte la question de la distinction progressive entre deux grands ensembles appelés à marquer durablement notre histoire (à grands traits les composantes latino-catholique et gréco-orthodoxe). En mobilisant le concept de géo-ecclésiologie, qui consiste à examiner, aux différentes- chelles, les objectifs stratégiques des protagonistes ecclésiastiques en fonction des priorités spatiales de leur agenda, l’étude ici proposée permettra de discerner les traits caractéristiques de la mission assignée au pape, à partir des documents choisis, face aux défis que présente le règne de
Justinien.
Pour télécharger la description complète du sujet et remplir un dossier de candidature pour cette thèse, rendez-vous sur le portail Thèses en Bretagne Loire.
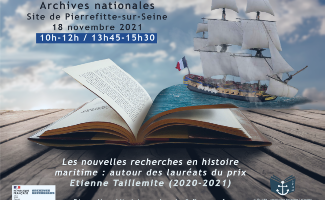
Prix Taillemite
La Société Française d’Histoire Maritime (SFHM) décerne chaque année le Prix Taillemite pour
encourager la jeune recherche en histoire maritime. Elle honore ainsi la mémoire d’Etienne Taillemite (1924-2011), inspecteur général des Archives, qui a consacré l’essentiel de sa carrière au traitement et à la mise en valeur des archives de la Marine et des Colonies.
En 2021, le prix de thèse universitaire a été décerné à Edern Olivier-Jegat, pour sa thèse Océans et marine française en paix, missions et stations navales (1763-1792) conduite sous la direction de Sylviane Llinares à l’Université Bretagne Sud.
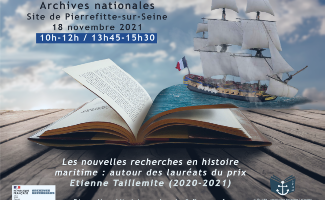 (Cliquer sur l’image pour accéder au programme complet)
(Cliquer sur l’image pour accéder au programme complet)
Prix de thèse de l’Académie de Marine
Edern Olivier-Jegat a également reçu, en juin 2022, le Prix de thèse de l’Académie de Marine.
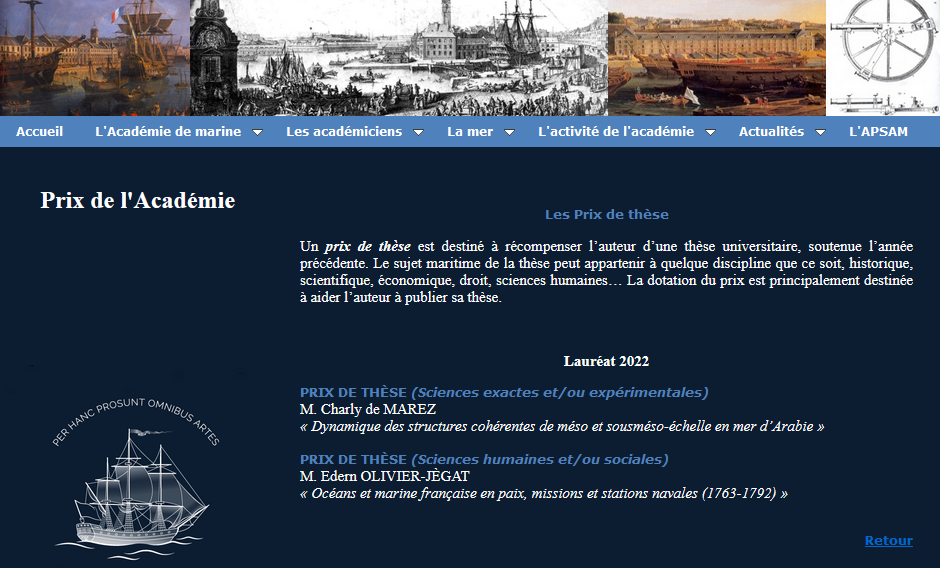
Un grand bravo à lui pour cette double réussite!

Qu’est-ce qu’une source en histoire ? Quel statut lui donner ? Quelle est sa matérialité ? Comment y accéder ? Quelle méthode employer pour la faire parler ? Quelles difficultés pose-t-elle aux historiennes et aux historiens ?
Ces premières rencontres doctorales proposent à chacune et à chacun de présenter une trace du passé, brute, de première main. On attend, a priori, une description de conditions qui en font une source historique. En effet, ce sont sans doute les usages pluriels d’un même document, de la microillustration à la démonstration sérielle, qui en font la richesse. L’approche critique est privilégiée, afin d’expliquer, au-delà de « l’aura » (W. Benjamin), comment faire parler des « témoins malgré eux » (M. Bloch).
Au fond, l’objectif de ces rencontres n’est pas de formuler une nouvelle définition épistémologique des sources (« L’historien et ses sources », colloque Paris I, 2003) mais d’élaborer une réflexivité à partir de l’expérience doctorale.
Cette journée d’étude, ouverte aux doctorantes et doctorants de TEMOS (UMR 9016 CNRS), se tiendra au Mans le jeudi 16 juin 2022.



Ce sujet de thèse est proposé par Didier Boisson, qui sera le directeur de la/du futur‧e doctorant‧e.
Le catéchisme apparait un élément essentiel mis en place par les Réformateurs du XVIe siècle pour développer et consolider les nouvelles confessions issues du schisme protestant. C’est le cas en particulier de Luther mais aussi de Calvin qui publie son Catéchisme en 1537. La thèse analysera la place du catéchisme dans les Églises réformées de France de la diffusion du calvinisme dans les années 1550 jusqu’à la Révocation de l’édit de Nantes en 1685. Il s’agira de s’intéresser à la place du catéchisme dans le culte réformé et la vie des huguenots, aux ouvrages de catéchisme publiés pendant cette période, à travers par exemple l’influence du catéchisme de Calvin, la diffusion de ces ouvrages et à leurs auteurs.
Il faudra envisager également comment les institutions du système consistorial-synodal (synodes nationaux, synodes provinciaux, colloques et consistoires) s’inscrivent sur la question du catéchisme dans le respect de la Confession de foi et de la Discipline ecclésiastique, mais aussi comment et quand est enseigné le catéchisme, par qui, et à quels fidèles est-il destiné. Quelle est ainsi la place du catéchisme dans le système éducatif réformé, des petites écoles aux académies en passant par les collèges ? Comment le catéchisme est-il perçu par les enfants et les adultes ?
On pourra aussi s’interroger sur les éventuelles particularités du catéchisme dans les Églises réformées de France par rapport à d’autres Églises calvinistes (Genève, Provinces-Unies, Écosse, Palatinat et les Églises du Refuge par exemple). Le catéchisme est aussi un élément de controverse confessionnelle entre réformés et catholiques. Outre les différences théologiques, peut-on observer des oppositions sur les méthodes d’enseignement, les pratiques ou les publics visés ?
Pour télécharger la description complète du sujet et remplir un dossier de candidature pour cette thèse, rendez-vous sur le portail Thèses en Bretagne Loire.
L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 13 juin 2022.

Cette journée d’études coorganisée par le CHS et TEMOS est placée sous le haut patronage de la Ministre déléguée auprès du Ministère des armées chargée de la Mémoire et des Anciens combattants:
LES PRISONNIERS DE GUERRE FRANÇAIS DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE : DE L’HISTOIRE À LA MÉMOIRE
Alexandre Millet, doctorant TEMOS à Université d’Angers, y fera une intervention intitulée:
Récits des PGF du Stalag 325 au prisme des régimes de mémoire de la captivité à Rawa-Ruska (1945-1965)
Voir le programme complet en PDF

Ce sujet de thèse est proposé par Florent Quellier, qui sera le directeur de la/du futur‧e doctorant‧e.
En s’appuyant essentiellement sur trois villes de l’Ouest de la France offrant des profils socio-économiques et des statuts politiques différents (Angers, « la belle endormie », Nantes, la négociante, et Rennes, la parlementaire), la thèse analysera le commerce des cosmétiques, au XVIIIe siècle, de l’annonce publicitaire à la table de toilette des consommateurs et des consommatrices en passant par les réseaux de vente, des maîtres parfumeurs aux regrattiers.
Il conviendra de voir si les réseaux de commercialisation des cosmétiques, les produits proposés à la vente et les arguments publicitaires sont identiques, ou adaptés au profil de chacune des villes sélectionnées, et d’apprécier les raisons sociales et culturelles qui président à l’achat de produits de beauté.
Le marché des cosmétiques ayant été étudié pour Paris (C. Delanoë, M. Martin), les résultats obtenus pour l’Ouest de la France seront comparés au cas parisien afin d’évaluer les éventuels décalages entre la capitale et la province et mesurer l’usage de la « capitale des modes » dans la promotion des pommades, fards et autres poudres cosmétiques au XVIIIe siècle.
Pour télécharger la description complète du sujet et remplir un dossier de candidature pour cette thèse, rendez-vous sur le portail Thèses en Bretagne Loire.
L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 10 juin 2021.
 Soutenu par la Commission européenne, le projet de recherche Breath (BRinging hEAlTH and social sciences to a new level through an interdisciplinary doctoral programme) cofinance un programme doctoral à l’interface des sciences humaines et sociales (SHS) et des disciplines de santé pour vingt jeunes chercheur∙es des Universités d’Angers, de Nantes, et du Mans. Le projet débutera en septembre 2025.
Soutenu par la Commission européenne, le projet de recherche Breath (BRinging hEAlTH and social sciences to a new level through an interdisciplinary doctoral programme) cofinance un programme doctoral à l’interface des sciences humaines et sociales (SHS) et des disciplines de santé pour vingt jeunes chercheur∙es des Universités d’Angers, de Nantes, et du Mans. Le projet débutera en septembre 2025.