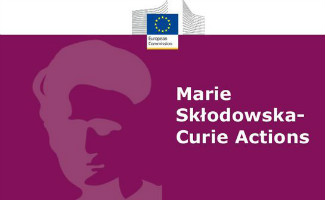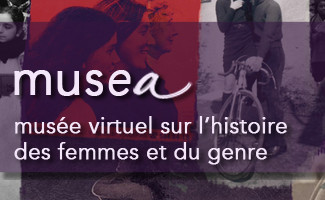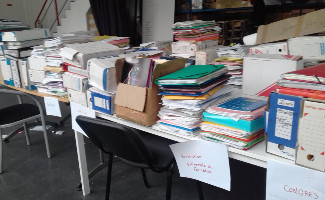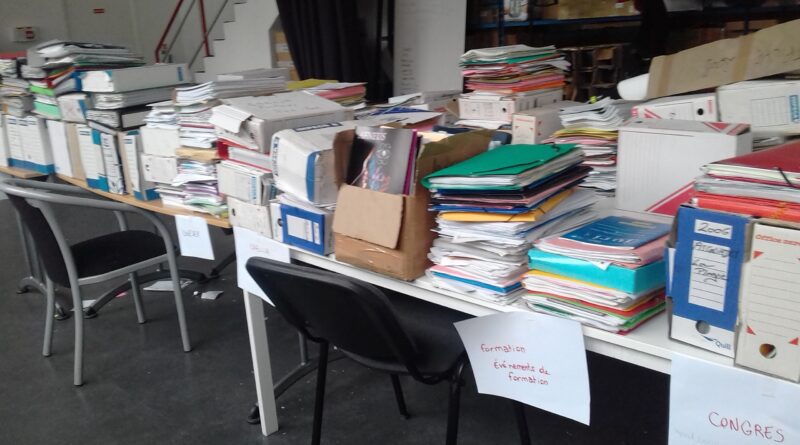La revue Temps, mondes, sociétés : l’histoire en dialogue interdisciplinaire publie des articles évalués en double-aveugle par des pairs, portant sur des recherches originales et novatrices qui mettent l’histoire (de l’Antiquité à nos jours) en dialogue avec d’autres disciplines : sciences humaines, sociales, expérimentales, exactes, de l’ingénieur, arts, etc. La revue publie en format numérique en accès libre deux numéros thématiques par an, auxquels s’ajoutent des articles varia et d’autres formats de publication.
Ces divers types de publication peuvent être ajoutés au fil de l’eau sur le site internet de la revue. La revue peut donc recevoir toute l’année vos propositions de publication.
Les langues de publication sont : le français, l’anglais et l’espagnol.
Dossiers thématiques
Les auteur.e.s intéressé.e.s peuvent proposer de coordonner des dossiers thématiques. Des articles disciplinaires peuvent construire une perspective pluri- ou multi- disciplinaire sur l’ensemble du numéro. Si celui-ci a vu le jour au cours d’une journée d’étude ou d’un colloque, le dossier doit nécessairement faire l’objet d’un appel renouvelé et ouvert à tou.te.s. Les dossiers peuvent également inclure d’autres formats de publication que les articles (voir plus loin). Les propositions de dossiers thématiques sont étudiées par le comité de rédaction. Les articles soumis sont évalués en double-aveugle.
Varia et autres formats de publication
Les auteur.e.s peuvent également proposer au fil de l’eau une contribution spontanée pour publier un article dans la rubrique Varia. Les articles peuvent être signés par un.e ou plusieurs auteur.e.s. Dans tous les cas, ils doivent aborder le sujet dans une perspective interdisciplinaire, avec une présence forte de l’histoire.
La revue est aussi ouverte à des formats nouveaux de publications, comme des data papers, des entretiens et portraits, l’édition de sources, les positions de thèse ou d’habilitation à diriger des recherches, comptes rendus d’ouvrages, de séminaires, de colloques ou de programmes de recherche.
Dès réception, les propositions sont étudiées par les membres du comité de rédaction pour voir si elles correspondent aux exigences de la revue. Les normes à respecter pour la rédaction des articles se trouvent sur ce site, qui comporte également le formulaire de soumission : Revue TMS.
Contacts : les co-rédactrices en chef, Hélène Vu Thanh et Cristiana Oghina-Pavie