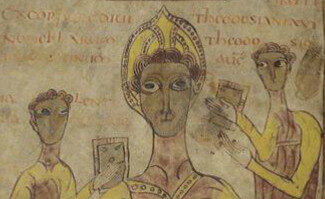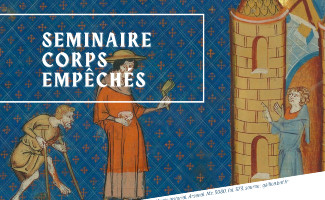Typologie d'événements : Séminaire
Séminaire ALMA | Année 2023-2024 | Semestre 2 #1
Avec Florence Alibert, maîtresse de conférences en humanités numériques (université d’Angers), Bénédicte Grailles, maîtresse de conférences en archivistique (université d’Angers), Elise Lehoux, maîtresse de conférences en gestion de données et bibliothéconomie (université d’Angers), Patrice Marcilloux, professeur d’archivistique (université d’Angers), Magalie Moysan, maîtresse de conférences en archivistique (université d’Angers), Véronique Sarrazin, maîtresse de conférences en histoire moderne (université d’Angers).
Séminaire « Religion et société » #mars2024
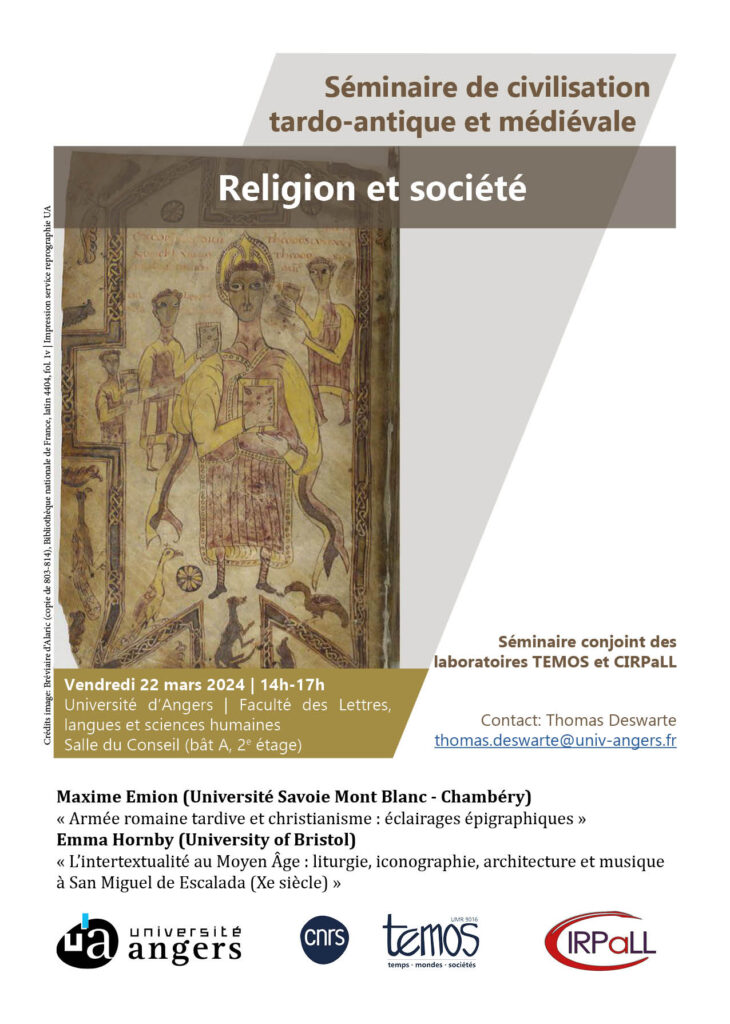
Objets, paraobjets, collections
L’histoire des savoirs face au patrimoine: une proposition par les «paraobjets» naturalistes
Si les historiennes et les historiens n’ont peut-être jamais autant réfléchi aux objets et à la matérialité des savoirs, le patrimoine savant actuel ne fait que très rarement partie de leur répertoire documentaire. C’est notamment le cas des collections naturalistes, qui posent autant des défis que des possibilités à l’histoire des savoirs. Dans ce séminaire, nous souhaiterions faire le point sur, et proposer au débat, la réflexion entamée lors de deux workshops (Paris, 2021 ; Bologne, 2022) autour de la notion de « paraobjets », lancée dans le cadre du projet Marie Skłodowska-Curie SCRIBSCIE (Scribal Science: Naturalists’ Paper Empire in France ca. 1660-1770, 2019–2022). Dans un projet à visée résolument expérimentale et collective, il s’agira d’interroger les dispositifs périphériques du patrimoine naturaliste, ces artefacts qui, sans être des spécimens, ont encadré leurs circulations dans l’espace et leurs significations changeantes dans le temps. Et, ce faisant, à penser, en historiennes et en historiens, les logiques de conservation et de patrimonialisation de ces collections—une condition préalable à leur mobilisation comme sources historiques.
Présentation de José Beltrán, Chargé de recherche CNRS, UMR TEMOS
Pour la visioconférence, contacter Mireille Loirat
Atelier de traduction latin-français
TEMOS / Cirpall – Projet Amorçage – MSH Ange-Guépin – Nantes Université
resp. Thomas Deswarte, Elisabeth Pinto-Mathieu et Christiane Veyrard-Cosme
Le commentaire de l’Apocalypse de Beatus de Liebana, rédigé à la fin du VIIIe s. dans les Asturies, est connu par de nombreux manuscrits magnifiquement enluminés. Il témoigne de la riche culture littéraire et religieuse de ce moine à une époque où, pourtant, l’écrit semble rare dans le nord-ouest péninsulaire. Ce texte se situe dans la tradition exégétique anti-millénariste du Commentaire de Tyconius et d’Augustin. Or, ce commentaire, par la suite largement diffusé dans toute l’Europe, demeure peu étudié et n’a jamais été traduit en français, tandis que ses traductions espagnole et anglaise sont perfectibles. Nous proposons donc de réaliser sa première traduction française à partir du texte latin de son édition au Corpus christianorum (Series Latina, 107B et 107C).
Juger et punir les enfants au XIXe siècle
Cette séance du séminaire de l’axe 1, intitulée « Juger et punir les enfants au XIXe siècle » et organisé en lien avec le Pôle EnJeux (Pôle universitaire ligérien d’études sur l’enfance-jeunesse), recevra deux intervenants:
Véronique Blanchard : «Un pénitencier à La Réunion : une histoire d’enfants, d’hommes et de pierres au milieu du XIXe siècle»
Alexandre Frondizi : « Juger les enfants insurgés : le cas des journées de juin 1848
La séance aura lieu le mercredi 17 mai de 13h30 à 15h, à la Passerelle de l’Université d’Angers au Campus de Belle-Beille. Il est également possible d’y assister à distance, en contactant Mireille Loirat.
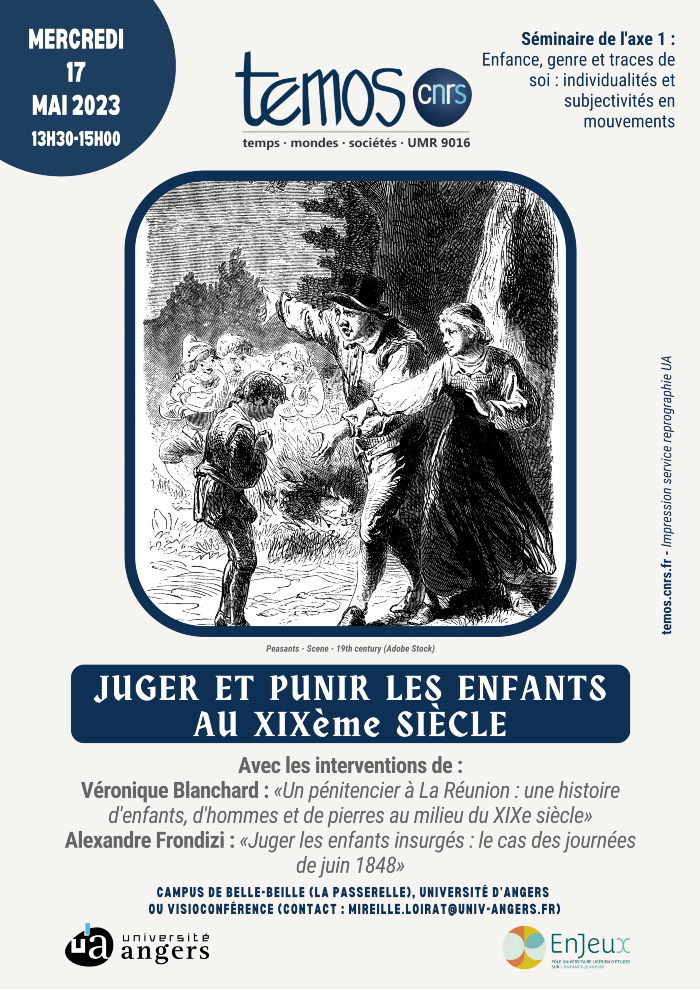
Séminaire « Religion et écriture » #mars23
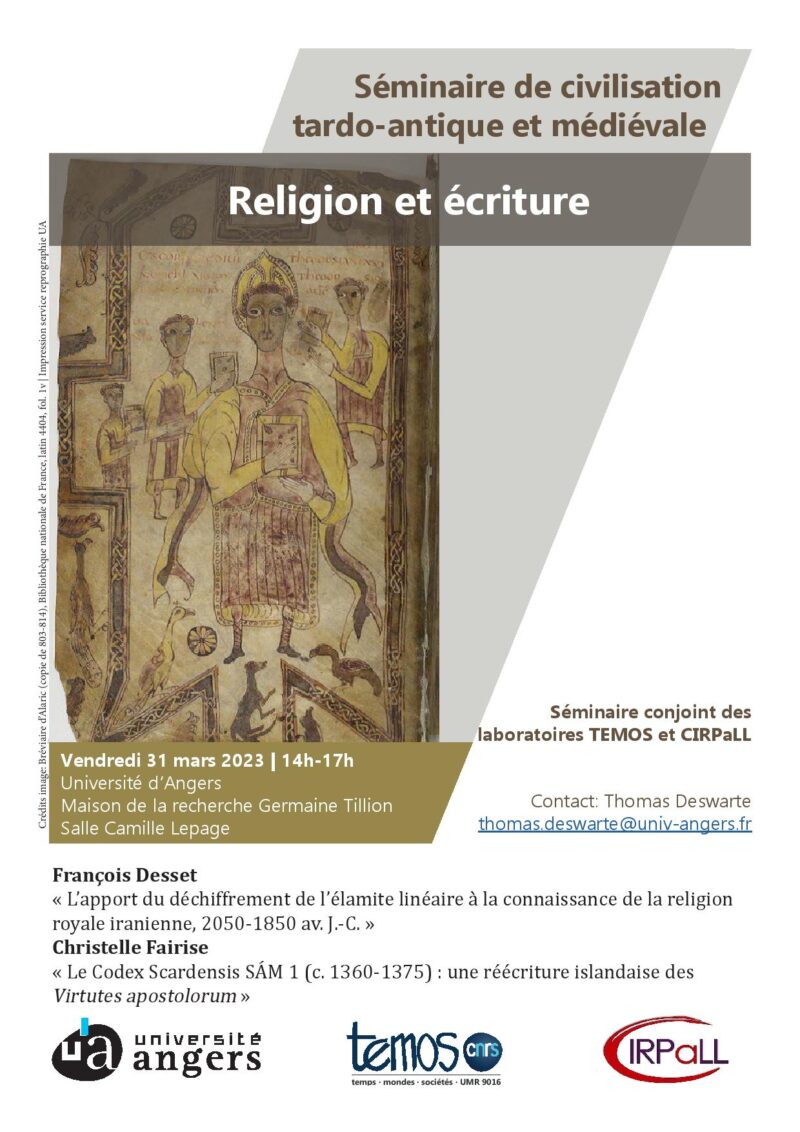
Lèpre et lépreux du Moyen Age
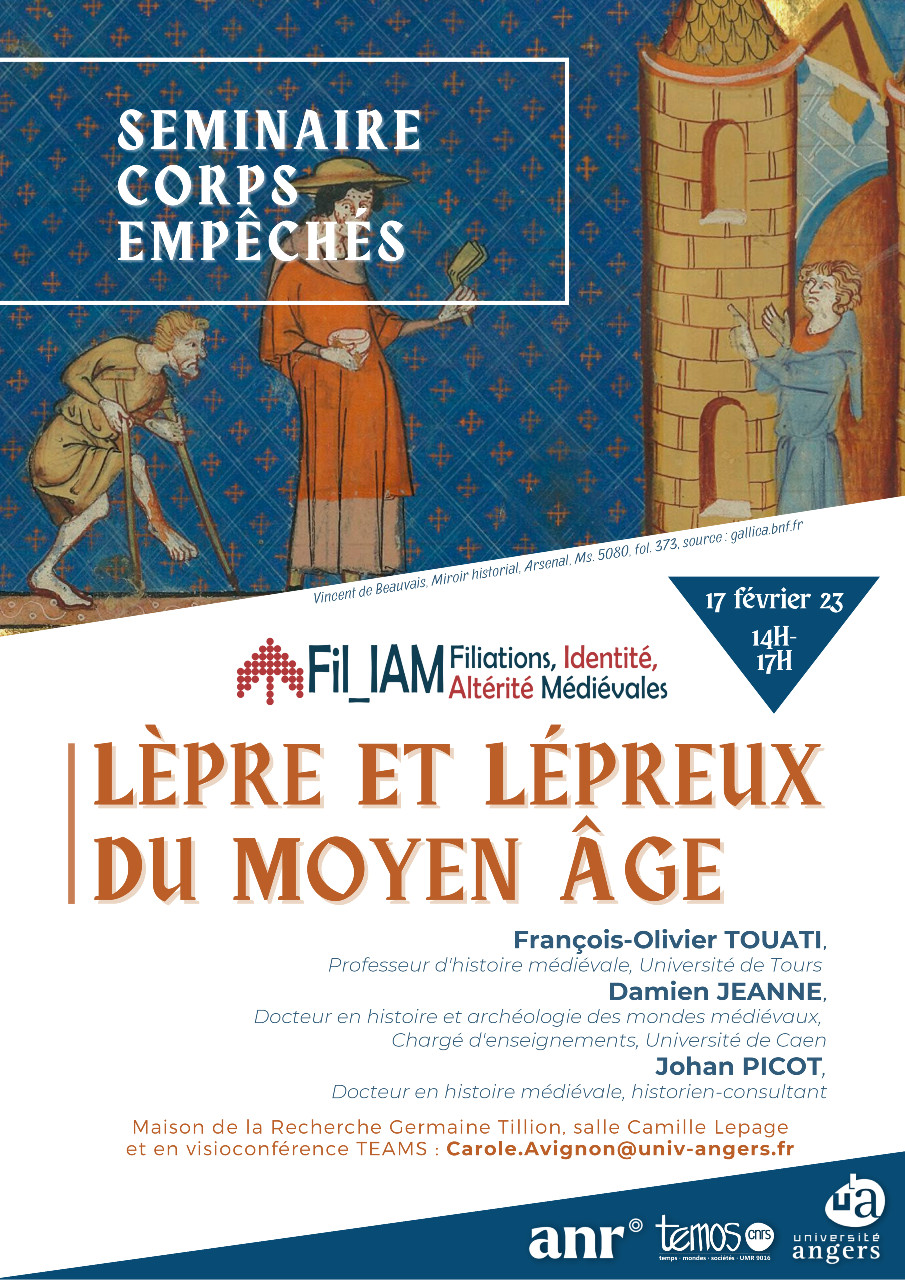
Programme
François-Olivier TOUATI
(EMAM-CNRS – Professeur d’histoire médiévale, Université de Tours)
De l’objurgation morale à l’étiologie : lèpre et infirmités dans le discours des Pères de l’Eglise et des canonistes, de saint Jérôme à Yves de Chartres.
Damien JEANNE
(Centre Michel-de-Boüard, CRAHAM – Docteur en histoire et archéologie des mondes médiévaux, Chargé d’enseignements, Université de Caen)
Distinguer entre lèpre et lèpre : les malades de la lèpre au risque de la société du Moyen Âge.
Johan PICOT
(Institut Ausonius – Docteur en histoire médiévale, historien-consultant)
La construction de la figure du lépreux à travers les sources du Tribunal de la Purge (XIVe-XVIe s.)
Séminaire organisé dans le cadre du programme ANR JCJC Fil_IAM Filiations, identité, altérité médiévales.
Séminaire ALMA | Année 2022-2023 | Semestre 2 #3
Patrice Marcilloux (Université d’Angers)
« Formes et moyens de l’engagement chez les archivistes au XXe siècle »
Cette séance s’inscrit dans la thématique 2022-2023 du séminaire:
Des vies : archivistes et bibliothécaires entre trajectoires personnelles, identités et représentations professionnelles
Enracinement dans une histoire positiviste au XIXe siècle, affirmation d’une technicité dès le XVIIIe siècle et de normes professionnelles au XXe siècle, la construction de l’identité professionnelle des archivistes et bibliothécaires paraît en première analyse s’être opérée à la faveur d’une mise à distance de l’individu. Et pourtant, notices nécrologiques, références aux grands anciens, publications de volumes de mélanges, rédaction de mémoires ou souvenirs autobiographiques : les indices d’une articulation durablement plus complexe entre processus d’individuation, identités et représentations collectives ne manquent pas. Le séminaire envisagera donc la question de la relation entre identité professionnelle et identité personnelle chez les archivistes et bibliothécaires : en quoi l’identité professionnelle construit-elle le sujet et, inversement, comment les identités individuelles participent-elles à la construction des identités professionnelles, en même temps qu’à l’affirmation de ces deux professions ?
Séminaire ALMA | Année 2022-2023 | Semestre 2 #2
Présentation de travaux d’étudiants
Cette séance s’inscrit dans la thématique 2022-2023 du séminaire:
Des vies : archivistes et bibliothécaires entre trajectoires personnelles, identités et représentations professionnelles
Enracinement dans une histoire positiviste au XIXe siècle, affirmation d’une technicité dès le XVIIIe siècle et de normes professionnelles au XXe siècle, la construction de l’identité professionnelle des archivistes et bibliothécaires paraît en première analyse s’être opérée à la faveur d’une mise à distance de l’individu. Et pourtant, notices nécrologiques, références aux grands anciens, publications de volumes de mélanges, rédaction de mémoires ou souvenirs autobiographiques : les indices d’une articulation durablement plus complexe entre processus d’individuation, identités et représentations collectives ne manquent pas. Le séminaire envisagera donc la question de la relation entre identité professionnelle et identité personnelle chez les archivistes et bibliothécaires : en quoi l’identité professionnelle construit-elle le sujet et, inversement, comment les identités individuelles participent-elles à la construction des identités professionnelles, en même temps qu’à l’affirmation de ces deux professions ?