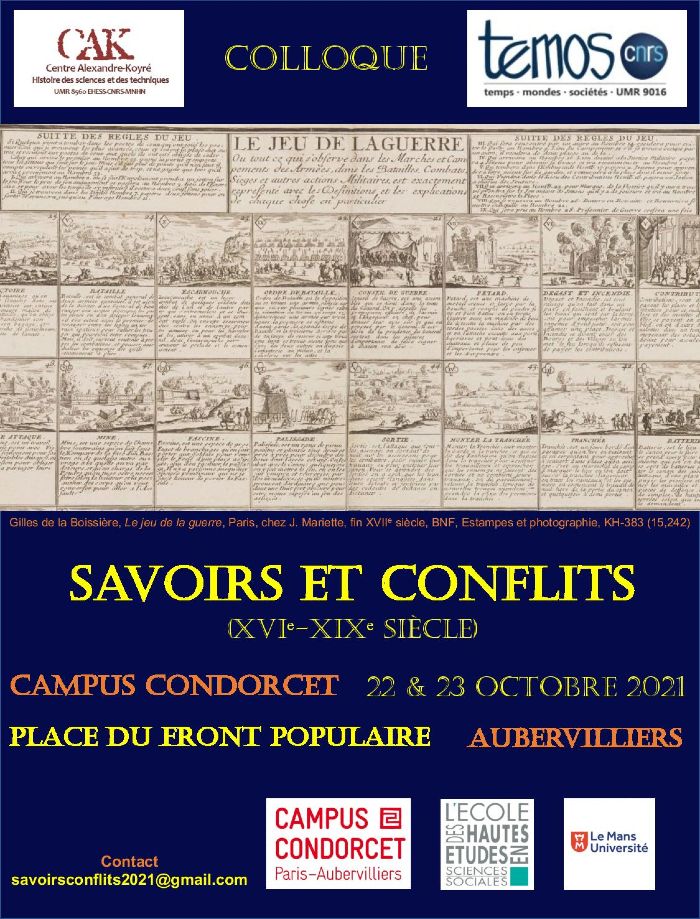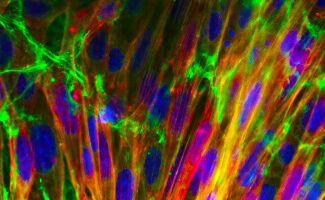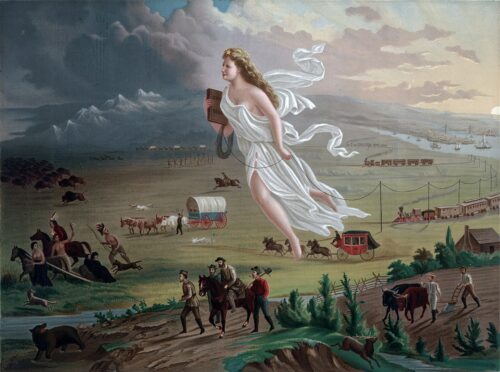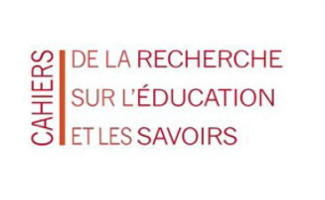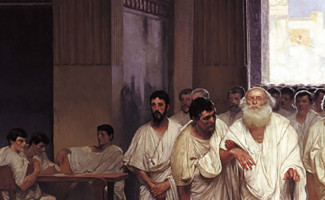Ce colloque international est organisé par Nahema Hanafi dans le cadre du programme ANR JCJC
Les castrats. Expériences de l’altérité au siècle des Lumières ANR-21-CE41-0001
Castrations. Entre histoire et études de genre
Depuis la seconde moitié du 20e siècle, la castration humaine – qui dans sa définition large concerne une ablation totale ou partielle des organes sexuels et reproducteurs – a fait l’objet de travaux historiques allant des castrations antiques assyriennes ou de la dynastie Chang aux castrations chimiques contemporaines. Des figures singulières ont émergé, comme celle des eunuques ottomans, des castrats italiens ou encore des Skoptzy, témoignant de la grande diversité des pratiques et des motivations, mais aussi de la nature même de la castration opérée.

A la suite de ces premiers travaux – qui ont documenté les dimensions religieuses, politiques, culturelles, socioéconomiques, artistiques, scientifiques ou pénales de la castration –, ce colloque invite à penser, dans un temps long allant de l’Antiquité à la période contemporaine, une histoire des castrations renouvelée par les perspectives des études de genre. S’il valorise une appréhension diachronique de ce phénomène, le colloque est ouvert à une pluralité de regards disciplinaires permettant d’analyser la castration comme un phénomène à la fois vécu et représenté. Il s’agit, sans se limiter non plus à une aire socioculturelle spécifique, d’interroger la manière dont la castration questionne les normes de genre des sociétés où elle est pratiquée, participant ainsi à leurs (re)définitions. […]
Lire l’appel à contribution sur Calenda
Les propositions de communication sont attendues pour le 31 mars 2022 à l’adresse suivante : nahema.hanafi[arobase]univ-angers.fr.
Le colloque aura lieu les 17 et 18 novembre 2022 à l’Université d’Angers.


![[AAC] Colloque « Savoirs et conflits (XVIe-XIXe siècle) »](https://temos.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/04/jeu-guerre.png)