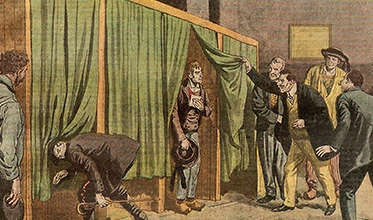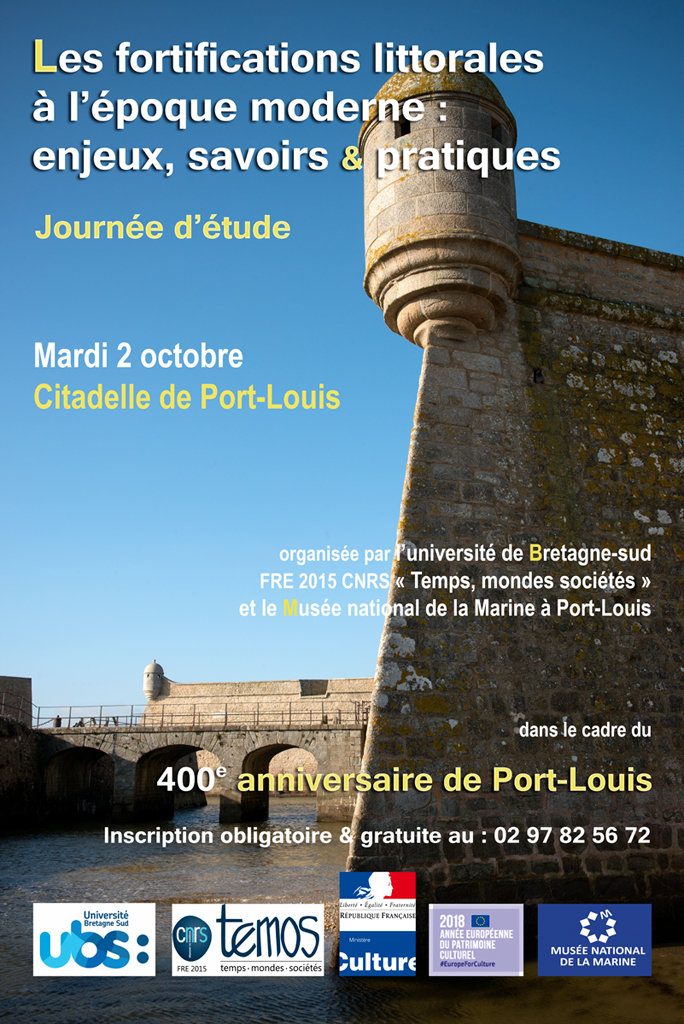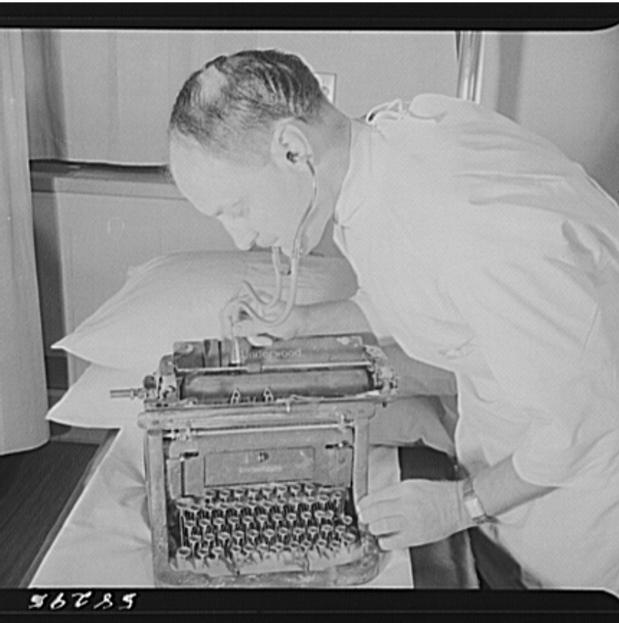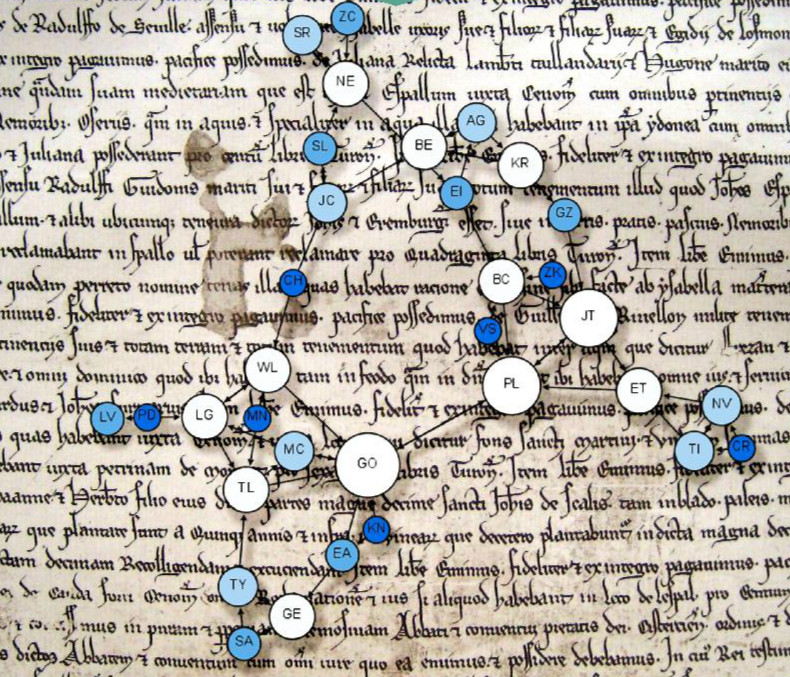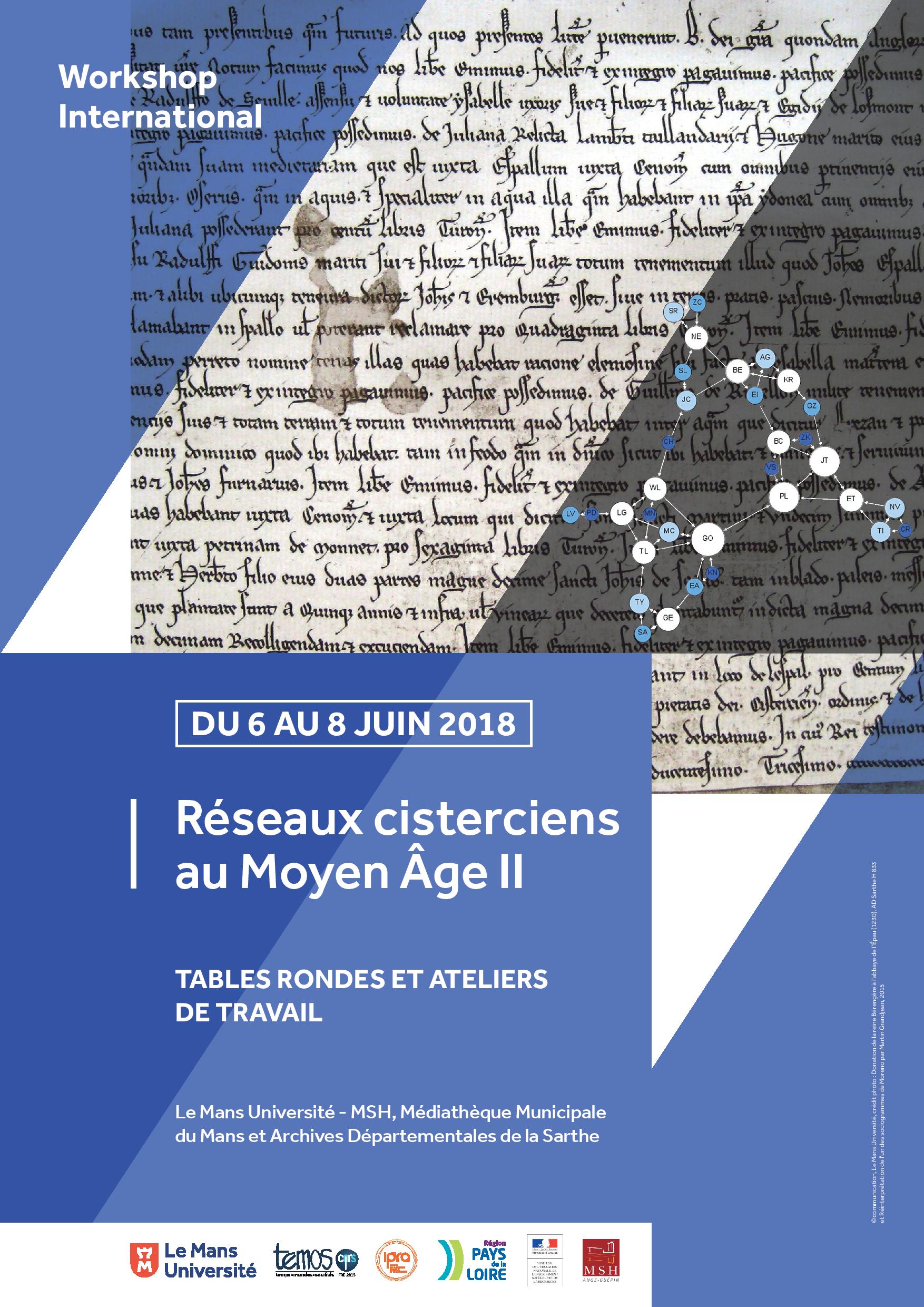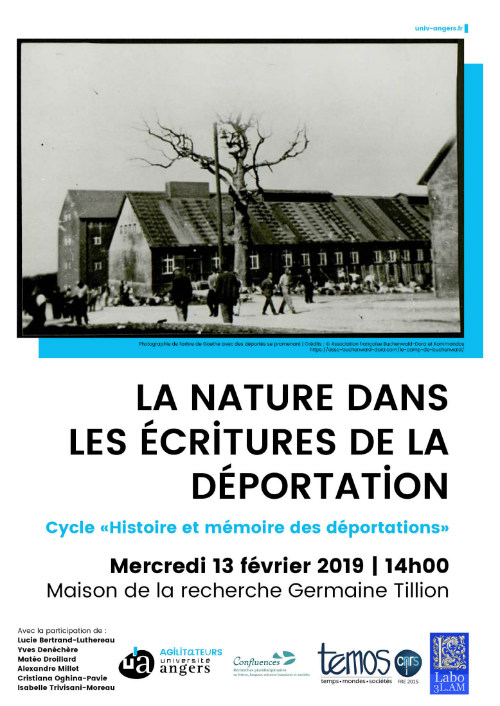
Programme
14h00 | Introduction | Yves Denéchère (professeur d’histoire contemporaine, Université d’Angers-TEMOS)
« L’arbre de Goethe » dans le camp de déportation de Buchenwald symbolise la permanence de la nature et de ce qu’elle peut représenter jusque dans les lieux les plus déshumanisés. Il est devenu l’un des emblèmes mémoriels du camp. Claude Lanzmann (disparu il y a quelques mois), a longuement donné à voir dans Shoah (1985) la nature qui, après la destruction de certains camps d’extermination par leurs constructeurs, a repris ses droits sur des terres ensanglantées. Les interventions de cette demi-journée interrogent le rapport des déporté.e.s avec la nature environnante. Le paysage, le climat, le végétal sont propices à des regards nouveaux sur l’écriture de la déportation par ceux qui l’ont endurée, qu’ils soient des écrivains reconnus ou des témoins qui ont été soucieux de laisser une trace.
14h15 | « « Le destin luxueux de la plante pourrissante ». Autour de la surdétermination du végétal en contexte concentrationnaire » | Lucie Bertrand-Luthereau (agrégée et docteure en lettres, IEP d’Aix-en-Provence – CHERPA)
Dans son récit concentrationnaire intitulé L’Espèce humaine, Robert Antelme suit la trame chronologique de sa détention et tisse autour de la réalité vécue une philosophie saisissante et neuve, issue d’une expérience infernale dans laquelle les valeurs sont renversées. Dans un passage clé de cet ouvrage, le détenu, épuisé par ce qu’on appellera plus tard les « marches de la mort », contemple la nature. Il livre alors une vision du végétal somptueuse et inédite, qui bouleverse la hiérarchie traditionnelle entre l’homme et la plante, la nature et le sort de celle-ci devenant douloureusement enviable. Robert Antelme n’est pas le seul rescapé dont les écrits témoignent d’un rapport nouveau et surdéterminé à la nature. Primo Levi, dans La Trêve, lui attribue le rôle vital d’antidote au « poison d’Auschwitz ». C’est à la nature si particulière de la surdétermination du végétal en contexte concentrationnaire que nous nous attacherons dans cette communication.
15h00 | « Le rôle de la nature à Rawa-Ruska, d’après des témoignages de prisonniers » | Alexandre Millet (doctorant en histoire, Université d’Angers-TEMOS)
À partir du 13 avril 1942, des prisonniers de guerre français et belges sont internés dans un camp de représailles à Rawa-Ruska, situé près de Lviv dans le Gouvernement Général de Pologne. Le « camp de la goutte d’eau et de la mort lente » se trouve aux abords de la ville. La nature apparait de différentes manières dans des récits d’anciens prisonniers du camp : la végétation est d’abord utilisée par les internés sous-alimentés pour se nourrir. Ensuite, les variations météorologiques extrêmes ont un impact sur l’aspect visuel du paysage et par conséquent sur le moral du captif et sur son état physique. Enfin, situé dans le « triangle de la mort », Rawa-Ruska est tout proche du théâtre de nombreux massacres de masse. Le dernier point envisagera la nature dans une perspective mémorielle.
15h45-16h00 Pause
16h00 | « De fougères en cimetières : écriture et réécriture du végétal dans deux récits de déportation de Pierre Gascar » | Cristiana Oghina-Pavie (maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Université d’Angers-TEMOS) et Isabelle Trivisani (maîtresse de conférences en lettres modernes, université d’Angers-3L.AM)
Après la Seconde Guerre mondiale où il connut l’enfermement, Pierre Gascar devient écrivain et publie une soixantaine d’œuvres : parmi elles, Le Temps des morts livre un témoignage sur le camp de Rawa-Ruska. Il faudrait en fait parler non pas d’un, mais de plusieurs témoignages, car l’ouvrage paru en 1953 – en même temps que Les Bêtes qui lui valut le prix Goncourt – est repris et profondément reconfiguré par son propre auteur au moins à deux reprises aussi bien sur le plan de la longueur que du titre, mais aussi des contenus. Malgré sa dimension biographique, le récit nous offre ainsi des versions multiples du vécu d’une même expérience par le même homme : au sein de cet ensemble protéiforme, quelques constantes tout de même, un cimetière à entretenir, désherber et fleurir et, pour cette raison, un motif, le végétal, qui fait partie des éléments récurrents de l’œuvre de Pierre Gascar. Mais de même qu’il n’y a pas une mais au moins trois œuvres, de même on ne rencontre pas qu’un mais au moins deux cimetières et de même encore le végétal ne saurait se présenter de façon unifiée mais mouvante à travers une écriture qui, au fil des mutations, en transforme les espèces, la place et la symbolique.
16h45 | Lecture d’extraits littéraires de L’espèce humaine de Robert Antelme et de Le temps des morts et Le règne végétal de Pierre Gascar | Par Matéo Droillard
17h15 Fin