Les dernières publications de nos chercheur.e.s.
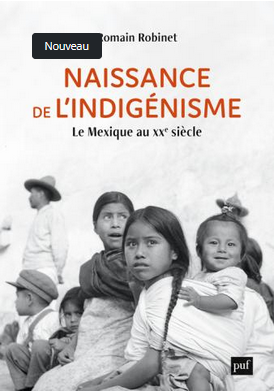
Naissance de l'indigénisme
Qu’est-ce qu’être indigène en Amérique latine ? Est-ce le fruit d’une situation coloniale, héritée des lointaines conquêtes ibériques ? Ou s’agit-il d’une identification politique plongeant en réalité ses racines dans une histoire beaucoup plus récente ? À l’heure des multiples débats sur le legs des empires coloniaux, cette enquête interroge le caractère socialement construit de l’indianité dans les Amériques contemporaines : la catégorie « indigène » doit en effet être appréhendée comme une ressource multidimensionnelle, déployée aussi bien par des États dits indigénistes que par un continuum d’organisations s’identifiant comme autochtones. L’indigénisme – dynamique transnationale, entreprise scientifique, politique publique, mouvement social et élan religieux – a bel et bien inventé l’indigène. Laboratoire de l’anthropologie appliquée, le Mexique révolutionnaire a été le fer de lance de l’indigénisme américain. Obsédées par l’idée d’une nation homogène, ses élites blanches et métisses ont continuellement cherché à « incorporer l’Indien à la civilisation », à grands renforts d’écoles, de coopératives, de routes et de dispensaires. Face à cette mission assimilatrice, les représentants autochtones se sont constamment mobilisés pour faire entendre les revendications politiques, sociales et culturelles de la « race indigène ». Enjeu de luttes permanentes, l’indigénisme est devenu ainsi le mode de décolonisation des Amériques au XXe siècle.

Habiter les faubourgs et les banlieues
Dans l’imaginaire commun, les banlieues sont associées à la relégation spatiale et envisagées comme des territoires « en crise ». Pourtant, l’histoire sociale a montré que faubourgs et banlieues sont habités par une population diversifiée selon qu’il s’agit d’espaces résidentiel, de loisir, artisanal et industriel ou de production agricole. Cet ouvrage s’inscrit dans ces renouvellements en donnant à voir la vie ordinaire des habitants et leurs manières d’habiter dans des formes d’habitat variées. Les expériences de patrimonialisation et de médiation dans différents quartiers, dont ces actes se font l’écho, participent à ces nouvelles approches. Du Moyen Âge jusqu’à nos jours, c’est un dialogue disciplinaire qui se noue en explorant des territoires divers et parfois inattendus. Ces actes sont issus du colloque organisé les 16 et 17 novembre 2023 au musée Jean-Claude Boulard du Mans.

Centaurus. Journal of the European Society for the History of Science, Volume 65 (2023), Issue 3
This special issue of Centaurus brings together historians from Latin America and Europe to trace the history of some scientific collections and museums, in order to reassess their significance and to draw a more nuanced international geography of the sciences. Our dossier focuses on “provincial” natural history and archaeology museums and collections. For the sake of simplicity, we use the term “provincial” to qualify these “peripheral” spaces that encompassed colonial and post-colonial territories as well as the European provincial regions, but the label is only a convention as some of these collections were sometimes displayed in national capitals. Focusing on objects, people, or institutions, with case studies from Mexico, Uruguay, Peru, Brazil, Northern Italy, Catalonia, and Switzerland, the articles gathered here reveal the scholarly practices and sociability of the many collectors, brokers, and go-betweens acting in the “provinces,” especially those of the amateurs. These essays show the relevance of the history of provincial collections to the wider history of scientific museums. Indeed, the shift of focus from the major institutions of the metropolitan capitals to the many collections and museums created in less central cities and regions sheds light on many issues that have remained in the background within the more centrally focused historiography.
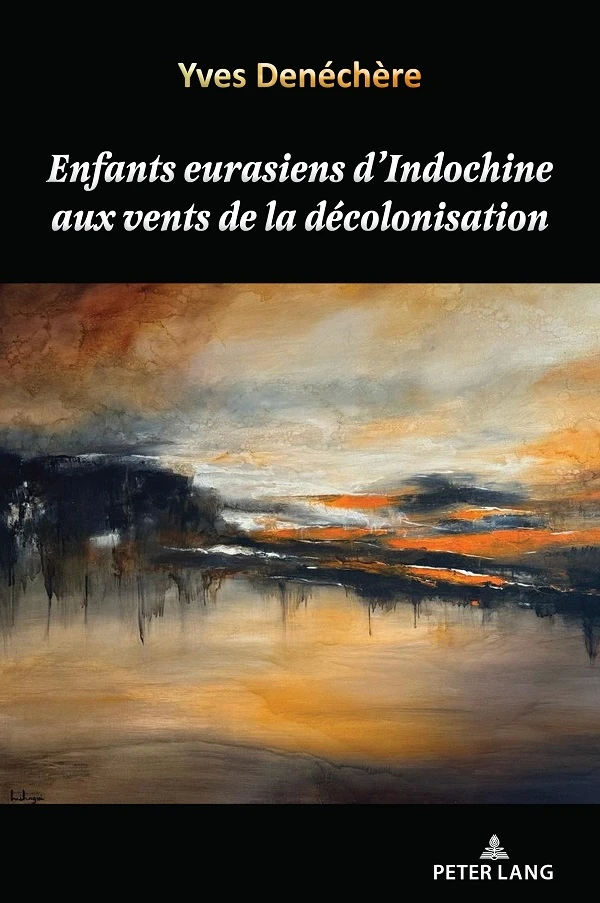
Enfants eurasiens d’Indochine aux vents de la décolonisation
Des milliers d’enfants métis nés dans l’Indochine coloniale ont été déplacés en France des années 1940 jusqu’au début des années 1970. Il s’agissait tout d’abord de former les jeunes eurasiens pour en faire des cadres pour la colonie puis, après la décolonisation, de les assimiler à la société française. Issues de la rencontre entre dominants et dominées, investies d’enjeux politiques et sociaux très forts, mais aussi idéologiques et démographiques, les personnes concernées ont dû se construire en métropole en tant que migrantes et métisses racisées. Grâce au croisement des archives avec de nombreuses sources orales et une enquête par questionnaire, ce livre reconstruit historiquement l’expérience d’acculturation et de construction subjective des Eurasiens et des Eurasiennes tout au long de leur vie. Le 70e anniversaire de la présence française en Indochine est l’occasion de sortir de l’ombre un pan méconnu de l’histoire coloniale et postcoloniale de la France.

Cloîtrées. Filles et religieuses dans les internats de rééducation du Bon-Pasteur d'Angers, 1940-1990
Depuis le XIXe siècle, la congrégation du Bon-Pasteur d’Angers prend en charge les jeunes filles des classes populaires considérées comme dangereuses ou « incorrigibles ». Elle occupe rapidement une position de quasi-monopole dans la rééducation des filles jusqu’aux années 1960. Par la voie de la justice, l’État, même devenu républicain et laïc, délègue aux congrégations religieuses le soin de corriger les « mauvaises filles », afin de leur permettre « de contracter des habitudes d’ordre et de travail propres à les ramener à la vertu ». Ainsi, 8 000 enfants sont passées entre les murs du couvent de la seule maison-mère d’Angers entre 1940 et 1991, date de sa fermeture. Contestées de toutes parts au tournant des « années 68 », y compris par les jeunes elles-mêmes, ces institutions entrent en crise pour mourir à petit feu. Un modèle moral, éducatif et économique a vécu, sans être à même de se réformer à travers le temps et marquant de son empreinte la vie de dizaines de milliers de jeunes filles.
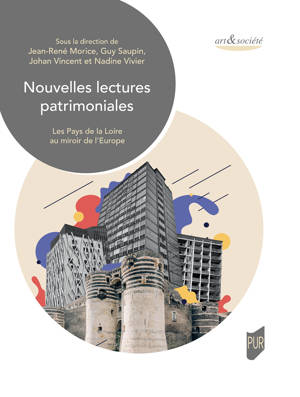
Nouvelles lectures patrimoniales. Les Pays de la Loire au miroir de l’Europe
Depuis une vingtaine d’années, les modes opératoires patrimoniaux se caractérisent par une volonté de dépassement des catégories anciennes distinguant le matériel et l’immatériel, le naturel et le culturel, le monumental et le vernaculaire, au profit d’une synergie résultant du croisement de toutes ces approches. La critique salutaire formulée par le reste du monde à une Europe qui avait imposé ses modèles, a entraîné un enrichissement de l’idée de patrimoine à toutes les échelles géographiques, et des interrogations. En replaçant les rapports sociaux et les représentations culturelles au cœur de l’analyse, les modes de lecture les plus récents donnent la priorité à une appréhension anthropologique des réalités patrimoniales et à une nécessaire co-construction permanente favorisée par les innovations numériques. La participation à la révélation du territoire en sort renouvelée. Les contributions ici réunies et articulées poursuivent le dialogue nourri depuis plus de dix ans au sein de la région Pays de la Loire. Profitant du moment fort de valorisation patrimoniale européenne voulue par le Conseil de l’Europe en 2018, elles se veulent en réaction à toutes les tentations de repli identitaire.
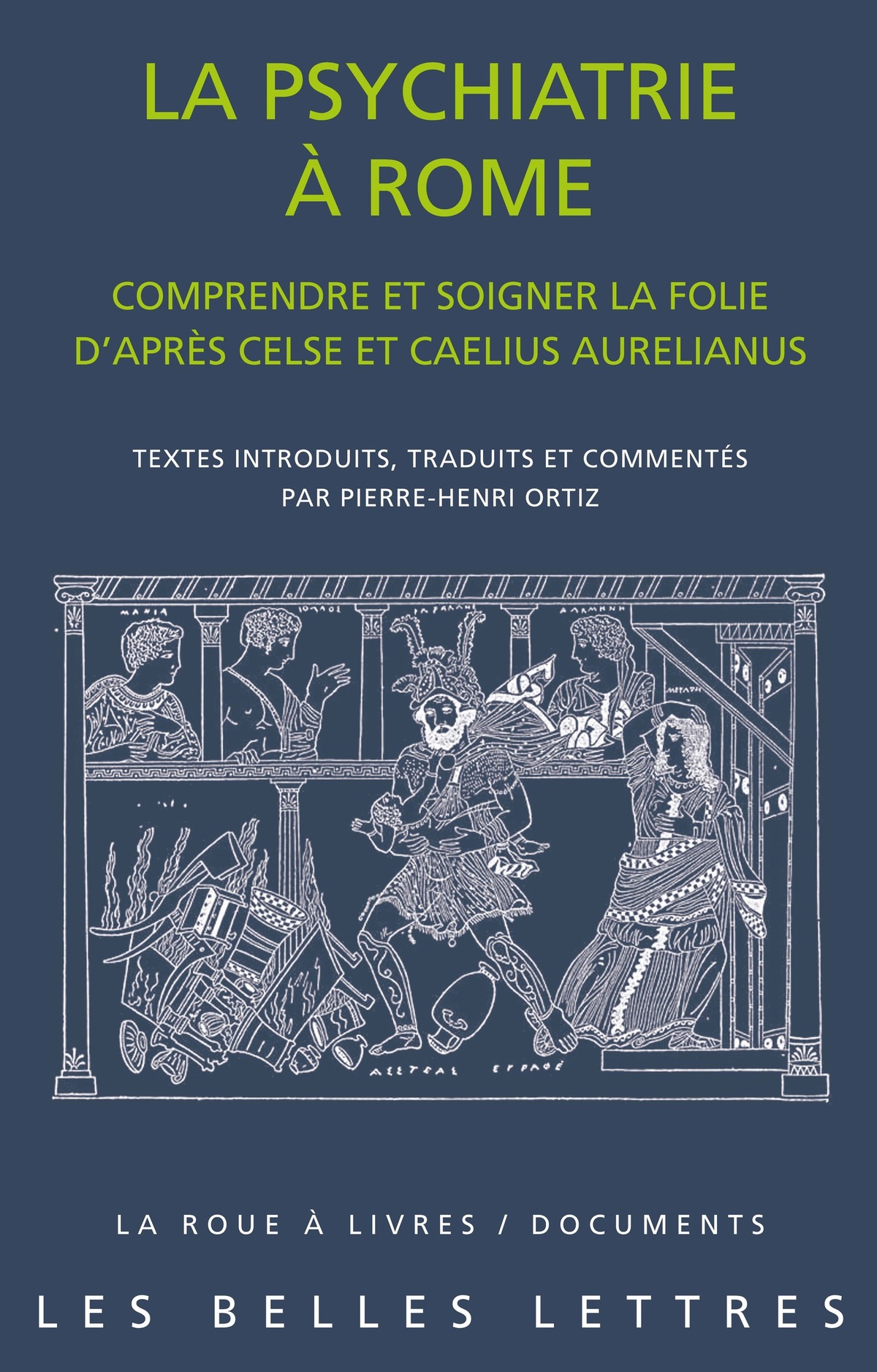
La psychiatrie à Rome. Comprendre et soigner la folie d'après Celse et Caelius Aurelianus
Dès les origines, les sociétés grecque et romaine reconnaissent dans les troubles mentaux les plus graves une maladie, qui est un enjeu social et appelle des réponses juridiques adaptées. Toutefois, ce n’est qu’à l’époque hellénistique et à Rome que naît véritablement la psychiatrie. L’accès relativement récent au corpus médical en traduction nous permet désormais de découvrir une période décisive dans laquelle émergent une pratique et une théorie psychiatriques complexes, très éloignées des préjugés les plus communément admis. La maladie mentale n’est pas l’objet d’une explication surnaturelle ; le trouble mental pur est pris en charge par la médecine, mais c’est à Rome plutôt qu’aux temps hippocratiques que cette évolution se produit ; cette extension du domaine de la médecine est liée au développement de remèdes inédits, ainsi qu’à la nouvelle configuration socio-économique et culturelle de l’empire. L’objectif de ce livre est de proposer un exposé synthétique, et en partie renouvelé, des débuts de cette histoire, et de donner à lire les textes majeurs de Celse (Ier s.ap. J.-C.), reprenant Asclépiade de Bithynie (IIe-Ier s. av. J.-C.), et de Caelius Aurelianus (Ve s. ap. J.-C.), reformulant en latin l’enseignement de Soranos d’Éphèse (IIe s. ap. J.-C.),traduit ici en français pour la première fois.

Œuvres complètes. Tome III Le Panegyric du Chevallier sans reproche
Le Panegyric du Chevallier sans reproche (1527) de Jean Bouchet raconte la vie de Louis II de La Trémoille (1460-1525), capitaine exemplaire tombé à Pavie. De longues instructions dans l’art d’aimer, de guerroyer et de gouverner font de cette biographie en partie romancée le miroir implicite d’un pouvoir royal à reconstruire.

Nuncius Volume 39 (2024): Issue 1 (Mar 2024): Special Issue: The Amateur Scientist’s Workshop (1800–1950): A History through Objects
This special issue looks at the history of science as practiced by amateurs during the nineteenth and twentieth centuries. Our approach to these scientific activities privileges objects as material and visual sources. As readers will note from the articles, the topic is interdisciplinary in nature: first and foremost, because the extremely varied field of amateur hobbies appeals equally to historians of science, the arts, or sports, as well as to social and cultural historians. Amateurs themselves are versatile enthusiasts with a wide range of tastes. They may also assume different identities via their practice: as layman, a member of a learned society, an independent investigator, or as one challenging professional science. The history of scientific amateurism therefore extends the history of scientific production to socio-cultural dynamics that go beyond the boundaries of legitimate science.
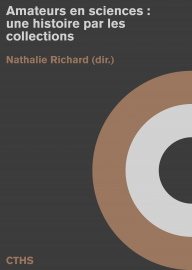
Amateurs en sciences : une histoire par les collections
Faits sociaux autant qu’ensembles d’objets à valeur symbolique, les musées et les collections rassemblent des êtres humains autant que des spécimens et ont à voir, de plusieurs manières, avec des communautés. Les contributions suivantes proposent d’entrer dans l’histoire des amateurs en sciences en mettant l’accent sur les pratiques de collecte, de conditionnement, de classement et de mise en scène des collections. Elles évoquent la manière dont ces pratiques construisent des savoirs et analysent les circulations d'hommes et d'objets qu'elles impliquent, de même que les usages sociaux auxquels elles donnent lieu. Le Congrès national des sociétés historiques et scientifiques rassemble chaque année universitaires, membres de sociétés savantes et jeunes chercheurs. Ce recueil est issu de travaux présentés lors du 145e Congrès sur le thème « Collecter, collectionner, conserver ».
