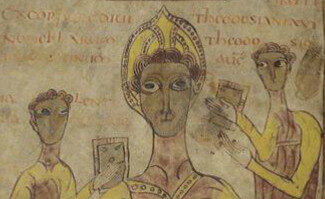Enracinement dans une histoire positiviste au XIXe siècle, affirmation d’une technicité dès le XVIIIe siècle et de normes professionnelles au XXe siècle, la construction de l’identité professionnelle des archivistes et bibliothécaires paraît en première analyse s’être opérée à la faveur d’une mise à distance de l’individu. Et pourtant, notices nécrologiques, références aux grands anciens, publications de volumes de mélanges, rédaction de mémoires ou souvenirs autobiographiques : les indices d’une articulation durablement plus complexe entre processus d’individuation, identités et représentations collectives ne manquent pas. Le séminaire envisagera donc la question de la relation entre identité professionnelle et identité personnelle chez les archivistes et bibliothécaires : en quoi l’identité professionnelle construit-elle le sujet et, inversement, comment les identités individuelles participent-elles à la construction des identités professionnelles, en même temps qu’à l’affirmation de ces deux professions ?
Séance 1
Anne Pérotin-Dumon, « On prend des risques. On gagne ou on perd » : Yves Pérotin (1922-1981), du partisan à l’archiviste
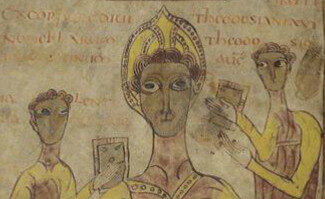
Pierre-Henri Ortiz (Université d’Angers)
« La folie religieuse dans le Code Théodosien : entre tradition rhétorique, donné biblique et paradoxe juridique »
Tristan Martine (Université d’Angers)
« Des aristocrates laïques et ecclésiastiques dans l’espace (IXe-XIe s.) : la Lotharingie entre deux royaumes et deux historiographies »
Lire la description complète du workshop sur le site de l’Université de Buenos Aires.

Conférence de François Kirbihler, maître de conférences en histoire romaine, Université de Lorraine
L’ascension des sénateurs d’Antioche de Pisidie : d’une colonie romaine au consulat et au patriciat
Séminaire ouvert à toutes et tous.

Conférence de Mathias Tranchant, professeur d’histoire médiévale, Université Bretagne Sud, TEMOS
Les ports maritimes de la France atlantique entre les XIe et XVe siècles
Séminaire ouvert à toutes et tous.

Programme
Philippe Hrodej et Aurélie Hess
“L’embarquer ensemble” pour la grande pêche : mesures et premières réflexions
Laurent Morival
Les troubles légitimistes en Vendée sous la Monarchie de Juillet : une nécessaire reconstruction du passé
Alexandre Millet
Traces et héritages d’une violence passée : les récits des prisonniers de guerre français du camp de Rawa-Ruska

Enracinement dans une histoire positiviste au XIXe siècle, affirmation d’une technicité dès le XVIIIe siècle et de normes professionnelles au XXe siècle, la construction de l’identité professionnelle des archivistes et bibliothécaires paraît en première analyse s’être opérée à la faveur d’une mise à distance de l’individu. Et pourtant, notices nécrologiques, références aux grands anciens, publications de volumes de mélanges, rédaction de mémoires ou souvenirs autobiographiques : les indices d’une articulation durablement plus complexe entre processus d’individuation, identités et représentations collectives ne manquent pas. Le séminaire envisagera donc la question de la relation entre identité professionnelle et identité personnelle chez les archivistes et bibliothécaires : en quoi l’identité professionnelle construit-elle le sujet et, inversement, comment les identités individuelles participent-elles à la construction des identités professionnelles, en même temps qu’à l’affirmation de ces deux professions ?
Séance 2
Marie de Séverac (Bibliothèque nationale de France)
Jules-Antoine Taschereau : portrait d’un journaliste bonapartiste devenu administrateur-général de la Bibliothèque impériale (1858-1874)
Télécharger le programme complet

Serge Reubi (Centre A.Koyré – Muséum national d’histoire naturelle)
Étudier les femmes scientifiques et leurs pratiques par la marge : les collectionneuses au service du Muséum national d’histoire naturelle
Télécharger le programme complet
Séminaire ouvert à toutes et tous.

Volny Fages (IDHES – ENS Paris -Saclay)
Marginalité et autorité scientifique dans l’astronomie française autour de 1900
Télécharger le programme complet
Séminaire ouvert à toutes et tous.

Fabien Simon (ICT (EA 337) – Université Paris Diderot)
Le Jewel de Thomas Urquhart (1652) et autres projets de langues universelles : aider la mémoire, simplifier les langues dans l’Europe du XVIIe siècle
Télécharger le programme complet
Séminaire ouvert à toutes et tous.